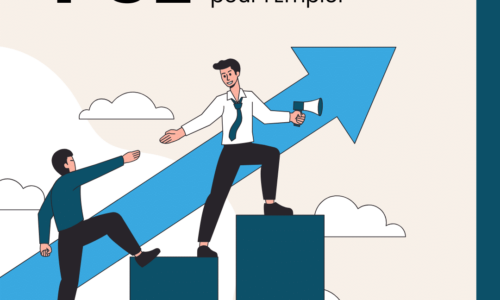En 2023, la France a enregistré une augmentation alarmante de 35% des liquidations judiciaires par rapport à l’année précédente, touchant plus de 57 000 entreprises et affectant des dizaines de milliers de salariés. Ces chiffres révèlent l’ampleur d’un phénomène aux conséquences humaines considérables.
La liquidation judiciaire représente souvent un moment traumatisant pour les salariés. Du jour au lendemain, ils perdent leur emploi et se retrouvent confrontés à un labyrinthe administratif et juridique complexe. Entre les créances salariales, les indemnités de licenciement et les démarches auprès de différents organismes, la période qui suit l’annonce d’une liquidation judiciaire est semée d’embûches.
Pourtant, les salariés disposent de droits spécifiques et de mécanismes de protection qu’il est essentiel de connaître pour traverser cette épreuve. Cet article vous propose de décrypter les enjeux de la liquidation judiciaire et d’identifier clairement les démarches à entreprendre pour préserver vos intérêts.
Comprendre la liquidation judiciaire
Définition et processus de liquidation judiciaire
La liquidation judiciaire constitue l’ultime étape des procédures collectives. Elle intervient lorsque deux conditions sont simultanément réunies : l’entreprise est en cessation de paiements (impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible) et son redressement est manifestement impossible.
Contrairement au redressement judiciaire qui vise à sauver l’entreprise, la liquidation a pour objectif de mettre fin à l’activité et de vendre les actifs pour désintéresser les créanciers selon un ordre précis établi par la loi.
Le processus s’enclenche généralement de trois façons différentes :
- À l’initiative du dirigeant lui-même (dans les 45 jours suivant la cessation des paiements),
- Sur assignation d’un créancier impayé,
- Sur saisine d’office du tribunal.
Une fois le tribunal saisi, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est prononcé après audition du dirigeant et des représentants du personnel. Ce jugement entraîne plusieurs conséquences immédiates :
1. L’arrêt de l’activité, sauf autorisation expresse du tribunal pour une période maximale de trois mois, renouvelable une fois,
2. Le dessaisissement du dirigeant au profit du liquidateur judiciaire,
3. L’exigibilité immédiate des créances non échues,
4. La suspension des poursuites individuelles des créanciers.
Le tribunal désigne deux acteurs clés pour superviser la procédure :
- le juge-commissaire, magistrat qui veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
- le liquidateur judiciaire, professionnel chargé de représenter les créanciers, de réaliser les actifs et de procéder aux licenciements.
Contrairement aux idées reçues, la liquidation judiciaire n’est pas toujours synonyme de faillite frauduleuse. Dans de nombreux cas, elle résulte de difficultés économiques objectives auxquelles l’entreprise n’a pas pu faire face malgré la bonne foi de ses dirigeants.

Les conséquences pour l’entreprise et ses salariés
Pour l’entreprise, les effets de la liquidation judiciaire sont radicaux et définitifs. L’activité cesse immédiatement, sauf décision contraire du tribunal pour préserver la valeur des actifs ou si l’intérêt public l’exige.
Le dirigeant se voit dessaisi de ses pouvoirs de gestion au profit du liquidateur judiciaire. Il ne peut plus effectuer d’actes de disposition ni engager l’entreprise. Dans certains cas, des sanctions personnelles peuvent être prononcées à son encontre, notamment en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Pour les salariés, les conséquences sont tout aussi brutales, mais encadrées par le droit du travail :
- Rupture des contrats de travail pour motif économique,
- Droit à des indemnités de licenciement et de préavis,
- Prise en charge des créances salariales par un organisme spécifique (l’AGS),
- Maintien temporaire de la couverture sociale.
Dans ce contexte particulier, les salariés bénéficient d’une protection renforcée pour leurs créances salariales. Celles-ci sont considérées comme privilégiées et bénéficient d’une garantie de paiement via l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS).
Toutefois, la liquidation judiciaire signifie aussi la fin de la communauté de travail. Les équipes sont dispersées, les projets abandonnés, et chacun doit rapidement se mobiliser pour rebondir professionnellement. Cette dimension psychologique ne doit pas être sous-estimée.
Le licenciement en cas de liquidation judiciaire
La procédure de licenciement économique et rôle du CSE
Dans le cadre d’une liquidation judiciaire, c’est le liquidateur, et non plus l’employeur, qui devient responsable de la mise en œuvre des licenciements. Ces derniers sont qualifiés d’économiques puisqu’ils résultent de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise.
Le processus suit une procédure accélérée par rapport aux licenciements économiques classiques, tout en respectant certaines obligations fondamentales.
#1 Consultation des représentants du personnel
Dans les entreprises dotées d’un Comité Social et Économique (CSE), celui-ci doit être consulté avant que le liquidateur ne procède aux licenciements. Cette consultation porte sur :
- Les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement,
- Le nombre de salariés concernés,
- Les catégories professionnelles visées,
- Les critères d’ordre des licenciements,
- Le calendrier prévisionnel.
Le CSE dispose d’un délai réduit pour émettre son avis, généralement entre 2 et 4 jours selon la taille de l’entreprise. Bien que cet avis soit consultatif, son absence pourrait entacher la régularité de la procédure.
#2 Critères d’ordre des licenciements
En principe, le liquidateur doit appliquer des critères objectifs pour déterminer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent en compte :
1. Les charges de famille,
2. L’ancienneté dans l’entreprise,
3. La situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile,
4. Les qualités professionnelles.
Toutefois, dans le cas d’une liquidation judiciaire entraînant la cessation totale d’activité, ces critères perdent de leur pertinence puisque tous les postes sont supprimés. Le liquidateur peut alors procéder au licenciement de l’ensemble du personnel.
#3 Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE)
Pour les entreprises de plus de 50 salariés envisageant le licenciement d’au moins 10 salariés sur 30 jours, un PSE devrait théoriquement être mis en place. Cependant, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, les obligations sont allégées compte tenu de l’impossibilité matérielle et financière de mettre en œuvre des mesures substantielles de reclassement.
Le liquidateur doit néanmoins proposer le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ou le Congé de Reclassement selon la taille de l’entreprise.

Notification du licenciement et rôles de la Dreets et du juge-commissaire
Une fois les formalités de consultation accomplies, le liquidateur doit franchir plusieurs étapes avant de pouvoir notifier les licenciements aux salariés.
#4 Autorisation préalable du juge-commissaire
Le liquidateur doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire avant de procéder aux licenciements. Cette autorisation prend la forme d’une ordonnance qui précise :
- Le nombre de salariés pouvant être licenciés,
- Les catégories professionnelles concernées,
- Le délai dans lequel les licenciements doivent intervenir.
Sans cette autorisation judiciaire, les licenciements seraient irréguliers. C’est une spécificité importante des licenciements en contexte de liquidation judiciaire.
#5 Les informations de la Dreets
Le liquidateur doit notifier à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) le projet de licenciement, généralement dans un délai de 8 jours suivant le prononcé du jugement de liquidation.
Cette notification comprend :
- La copie du jugement prononçant la liquidation,
- L’identité des salariés concernés,
- Les mesures envisagées pour limiter les conséquences des licenciements,
- Le calendrier prévisionnel des ruptures.
La Dreets exerce ici un rôle d’information et de contrôle, mais n’a pas de pouvoir d’opposition aux licenciements dans ce contexte particulier.
#6 Notification individuelle des licenciements
Après avoir obtenu l’autorisation du juge-commissaire et informé la Dreets, le liquidateur procède à la notification individuelle des licenciements. Chaque salarié reçoit une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit mentionner :
1. Le motif économique du licenciement (en l’occurrence, la liquidation judiciaire),
2. La priorité de réembauche pendant un an,
3. La possibilité de bénéficier du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP).
Contrairement à certaines idées reçues, la lettre de licenciement doit être motivée même en cas de liquidation judiciaire. Une absence de motivation constituerait une irrégularité susceptible d’ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Le délai d’envoi de ces notifications est relativement court : généralement 15 jours à compter du jugement d’ouverture de la liquidation, sauf en cas de maintien provisoire de l’activité.
#7 Contestation possible
Les salariés disposent d’un délai de 12 mois à compter de la notification de leur licenciement pour le contester devant le conseil de prud’hommes. Cette contestation peut porter sur :
- L’irrégularité de la procédure,
- L’absence de cause réelle et sérieuse,
- Le non-respect des critères d’ordre.
Toutefois, la jurisprudence considère généralement que la liquidation judiciaire constitue en elle-même une cause économique de licenciement, ce qui rend difficile la contestation du motif.
Les droits et indemnités des salariés en cas de liquidation judiciaire
Indemnités de licenciement pour liquidation judiciaire
Les salariés licenciés dans le cadre d’une liquidation judiciaire ont droit aux mêmes indemnités que lors d’un licenciement économique classique. Ces indemnités comprennent notamment :
- L’indemnité légale de licenciement pour les salariés ayant au moins 8 mois d’ancienneté,
- L’indemnité compensatrice de préavis, puisque le préavis n’est généralement pas exécuté,
- L’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés acquis mais non pris.
L’indemnité légale de licenciement est calculée selon les règles suivantes :
| Ancienneté | Calcul de l’indemnité |
|---|---|
| Moins de 10 ans | ¼ mois de salaire par an |
| À partir de 10 ans | ⅓ mois par an au-delà de 10 ans |
Par exemple, un salarié avec 12 ans d’ancienneté et un salaire mensuel brut de 2 500 € percevra :
- Pour les 10 premières années : 10 × (2 500 × 1/4) = 6 250 €,
- Pour les 2 années au-delà de 10 ans : 2 × (2 500 × 1/3) = 1 667 €,
- Soit un total de 7 917 € d’indemnité légale de licenciement.
Il est important de vérifier si votre convention collective prévoit des indemnités plus favorables que le minimum légal. Dans ce cas, c’est l’indemnité conventionnelle qui s’applique.
L’indemnité compensatrice de préavis correspond à la rémunération que vous auriez perçue si vous aviez travaillé pendant la période de préavis. Sa durée varie selon votre ancienneté et votre statut :
- 1 mois pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté,
- 2 mois pour les salariés ayant au moins 2 ans d’ancienneté,
- 3 mois pour les cadres (selon la plupart des conventions collectives).
Ces indemnités constituent des créances privilégiées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, l’entreprise n’ayant généralement plus les moyens de les verser, c’est l’AGS qui intervient pour garantir leur paiement.
Salaires impayés : Rôle de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)
L’AGS constitue un filet de sécurité essentiel pour les salariés confrontés à la défaillance de leur employeur. Cet organisme, financé par les cotisations des employeurs, garantit le paiement des sommes dues aux salariés lorsque l’entreprise n’est plus en mesure de les honorer.
L’intervention de l’AGS n’est pas automatique. Elle est déclenchée par le mandataire judiciaire ou le liquidateur, qui établit les relevés de créances salariales et les transmet à l’AGS. Celle-ci avance alors les sommes dues aux salariés dans des délais relativement courts, généralement entre 3 et 6 semaines après la transmission des relevés.
L’AGS couvre plusieurs types de créances :
- Les salaires et accessoires impayés (primes, commissions, etc.),
- Les indemnités de congés payés,
- Les indemnités de préavis,
- Les indemnités de licenciement (légales ou conventionnelles),
- Les dommages et intérêts alloués par décision de justice.
Cependant, cette garantie n’est pas illimitée. Elle est plafonnée à un montant qui varie selon l’ancienneté du contrat de travail par rapport à l’ouverture de la procédure collective :
| Ancienneté du contrat | Plafond 2023 |
|---|---|
| + de 2 ans avant procédure | 86 142 € |
| Entre 6 mois et 2 ans | 107 677 € |
| – de 6 mois | 129 212 € |
Ces plafonds sont suffisamment élevés pour couvrir les créances de la grande majorité des salariés.
Mais comment se déroule une procédure de paiement par l’AGS ?
Le processus se déroule généralement comme suit :
1. Le liquidateur établit un relevé des créances salariales pour chaque salarié,
2. Ce relevé est transmis à l’AGS et affiché dans les locaux de l’entreprise,
3. Les salariés disposent d’un délai de 10 jours pour contester les montants auprès du conseil de prud’hommes,
4. En l’absence de contestation, l’AGS verse les sommes au liquidateur,
5. Le liquidateur procède ensuite au paiement des salariés.
Si vous constatez des erreurs ou des omissions dans le relevé de vos créances, n’hésitez pas à les signaler rapidement au liquidateur et, si nécessaire, à saisir le conseil de prud’hommes.

Le rôle des ressources humaines pour gérer humainement une liquidation
Anticiper la communication
Un silence prolongé nourrit la rumeur et la défiance. Même si tout ne peut être dit, adoptez une posture claire et empathique :
- Mettez en place une communication régulière (emails internes, réunions d’information) dès les premiers signes de difficultés,
- Organisez des temps d’échange dédiés (individuels et collectifs) pour répondre aux inquiétudes,
- Travaillez main dans la main avec les délégués du personnel ou le CSE pour diffuser les bonnes informations.
Préparer en amont les dossiers salariés
Le rôle du RH dans la liquidation, c’est aussi l’organisation documentaire. Préparez des dossiers solides pour chaque salarié, comprenant :
- Contrat de travail,
- Fiches de paie des 12 derniers mois,
- Relevé de congés payés,
- Primes, bonus, heures supplémentaires, etc.
Cela permettra un traitement rapide par le liquidateur et un versement accéléré par l’AGS.
Faciliter le lien avec le liquidateur et l’AGS
Soyez le point de contact opérationnel pour les parties externes. Cela implique de :
- Répondre rapidement aux demandes du liquidateur,
- Fournir les justificatifs manquants,
- Informer les salariés des délais prévus de paiement,
- Centraliser les éventuelles contestations ou oublis dans les relevés.
Penser accompagnement psychologique
N’oubliez pas l’impact humain. Une liquidation, c’est un deuil professionnel. En tant que RH, vous pouvez proposer :
- Un accès à un cellule d’écoute psychologique (via un partenaire, un EAP ou un cabinet spécialisé),
- Un accompagnement à la reconversion ou à la rédaction de CV,
- Des ateliers de simulation d’entretien.
Une liquidation peut être un vrai choc. En tant que RH, offrez un accompagnement psychologique pour soutenir vos équipes.
Ainsi, la liquidation judiciaire représente une épreuve particulièrement difficile pour les salariés qui y sont confrontés. Au choc de la perte d’emploi s’ajoute la complexité des procédures et l’incertitude quant au paiement des sommes dues.
Toutefois, comme nous l’avons vu tout au long de cet article, le droit français prévoit des mécanismes de protection substantiels pour les salariés dans ce contexte. De la procédure spécifique de licenciement à l’intervention de l’AGS, en passant par les diverses indemnités et dispositifs d’accompagnement, ces protections visent à atténuer l’impact social de la défaillance de l’entreprise.
Il est important de garder à l’esprit que chaque situation de liquidation judiciaire présente des particularités liées au secteur d’activité, à la taille de l’entreprise, à sa convention collective ou encore à sa situation financière. C’est pourquoi un accompagnement personnalisé est souvent nécessaire pour s’y retrouver.
La liquidation judiciaire marque la fin d’une entreprise, mais elle ne doit pas signifier la fin d’un parcours professionnel. Avec les bons outils et le bon accompagnement, elle peut devenir, paradoxalement, le point de départ d’une nouvelle étape professionnelle !